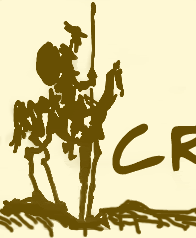


¡Ay de aquel que navega, el cielo oscuro, por mar no usado
y peligrosa vía, adonde norte o puerto no se ofrece!
y peligrosa vía, adonde norte o puerto no se ofrece!
Don Quijote, cap. XXXIV
Email
janercr@terra.com.br
Ebooks Brasil Arquivos
outubro 2003
dezembro 2003
janeiro 2004
fevereiro 2004
março 2004
abril 2004
maio 2004
junho 2004
julho 2004
agosto 2004
setembro 2004
outubro 2004
novembro 2004
dezembro 2004
janeiro 2005
fevereiro 2005
março 2005
abril 2005
maio 2005
junho 2005
julho 2005
agosto 2005
setembro 2005
outubro 2005
novembro 2005
dezembro 2005
janeiro 2006
fevereiro 2006
março 2006
abril 2006
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
setembro 2006
outubro 2006
novembro 2006
dezembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
março 2007
abril 2007
maio 2007
junho 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
novembro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
fevereiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
abril 2009
maio 2009
junho 2009
julho 2009
agosto 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
dezembro 2009
janeiro 2010
fevereiro 2010
março 2010
abril 2010
maio 2010
junho 2010
julho 2010
agosto 2010
setembro 2010
outubro 2010
novembro 2010
dezembro 2010
janeiro 2011
fevereiro 2011
março 2011
abril 2011
maio 2011
junho 2011
julho 2011
agosto 2011
setembro 2011
outubro 2011
novembro 2011
dezembro 2011
janeiro 2012
fevereiro 2012
março 2012
abril 2012
maio 2012
junho 2012
julho 2012
agosto 2012
setembro 2012
outubro 2012
novembro 2012
dezembro 2012
janeiro 2013
fevereiro 2013
março 2013
abril 2013
maio 2013
junho 2013
julho 2013
agosto 2013
setembro 2013
outubro 2013
novembro 2013
dezembro 2013
janeiro 2014
fevereiro 2014
março 2014
abril 2014
maio 2014
junho 2014
julho 2014
agosto 2014
setembro 2014
novembro 2014
janercr@terra.com.br
Tiragem

Janer Cristaldo escreve no
Jornaleco
Brazzil
Baguete
Crônicas Anteriores
Ebooks Brasil Arquivos
outubro 2003
dezembro 2003
janeiro 2004
fevereiro 2004
março 2004
abril 2004
maio 2004
junho 2004
julho 2004
agosto 2004
setembro 2004
outubro 2004
novembro 2004
dezembro 2004
janeiro 2005
fevereiro 2005
março 2005
abril 2005
maio 2005
junho 2005
julho 2005
agosto 2005
setembro 2005
outubro 2005
novembro 2005
dezembro 2005
janeiro 2006
fevereiro 2006
março 2006
abril 2006
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
setembro 2006
outubro 2006
novembro 2006
dezembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
março 2007
abril 2007
maio 2007
junho 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
novembro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
fevereiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
abril 2009
maio 2009
junho 2009
julho 2009
agosto 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
dezembro 2009
janeiro 2010
fevereiro 2010
março 2010
abril 2010
maio 2010
junho 2010
julho 2010
agosto 2010
setembro 2010
outubro 2010
novembro 2010
dezembro 2010
janeiro 2011
fevereiro 2011
março 2011
abril 2011
maio 2011
junho 2011
julho 2011
agosto 2011
setembro 2011
outubro 2011
novembro 2011
dezembro 2011
janeiro 2012
fevereiro 2012
março 2012
abril 2012
maio 2012
junho 2012
julho 2012
agosto 2012
setembro 2012
outubro 2012
novembro 2012
dezembro 2012
janeiro 2013
fevereiro 2013
março 2013
abril 2013
maio 2013
junho 2013
julho 2013
agosto 2013
setembro 2013
outubro 2013
novembro 2013
dezembro 2013
janeiro 2014
fevereiro 2014
março 2014
abril 2014
maio 2014
junho 2014
julho 2014
agosto 2014
setembro 2014
novembro 2014
quinta-feira, março 27, 2008
NOTRE JARDIN DE TOLÈDE
Lecteurs vagabonds et sans méthode, il nous arrive de rencontrer, dans l’Histoire de la Littérature, des auteurs insolites qui ne rejettent pas seulement toutes les règles de construction d’une oeuvre littéraire, mais aussi le comportement “raisonnable” que l’on attend d’un humaniste. Swift a été l’un d’eux. Octave Mirbeau en est un autre. (Villiers de L’Isle-Adam ne devrait pas non plus être laissé de côté). Si Swift, homme du XVIIIe siècle, bénéficie aujourd’hui d’une véritable reconnaissance littéraire, il n’en va pas de même de Mirbeau, qui est mort à l’aube du siècle dernier. Politiquement incorrect avant la lettre, cet écrivain singulier est tombé dans un purgatoire d’oubli, auquel il est en train d’échapper, grâce au travail persistant de lecteurs dévoués. Parmi eux, il convient de saluer l’imposant travail de Pierre Michel. Chasseur implacable de tout ce qui touche un tant soit peu cet auteur, ce professeur d’Angers, fondateur de la Société Octave Mirbeau, a réalisé ce miracle de trouver, dans un de mes romans oubliés, des références à l’auteur du Jardin des supplices.
Grâce à Buñuel, et, plus précisément, à son Journal d’une femme de chambre, j’avais déjà une vague idée de Mirbeau. Nous avons déjà là la marque de fabrique de l’auteur : dans une atmosphère décadente, une femme de chambre se soumet au fétichisme d’un de ses patrons et finit par se marier avec un domestique assassin et violeur d’enfant, ingrédients qui ne pouvaient que plaire au cinéaste espagnol, même s’il a modifié le dénouement. Mais la lecture qui m’a marqué le plus profondément a été celle du Jardin des supplices. De ses pages, ai-je écrit à l’époque, émane une odeur lugubre de fleurs pourries.
Le personnage central de l’oeuvre est, sans aucun doute, Miss Clara, citoyenne anglaise héritière d’une fortune laissée par son père, qui faisait le commerce d’opium à Canton. Clara ne trouve de plaisir que dans la contemplation de la torture et de la mort. L’auteur nous conduit au bagne de Canton, où un bourreau exalte l’antique art de la torture des Chinois et déplore la décadence de l’Occident, qui a perdu ce raffinement:
- L'art, milady, consiste à savoir tuer, selon des rites de beauté dont nous autres Chinois connaissons seuls le secret divin... Savoir tuer !... Rien n'est plus rare, et tout est là... Savoir tuer !... C'est-à-dire travailler la chair humaine, comme un sculpteur sa glaise ou son morceau d'ivoire… en tirer toute la somme, tous les prodiges de souffrance qu'elle recèle au fond de ses ténèbres et de ses mystères... Voilà !... Il y faut de la science, de la variété, de l'élégance, de l'invention... du génie, enfin...
Le supplice du rat: un rat affamé placé dans un pot avec un petit orifice fixé contre les fesses d’un condamné. Avec un fer rougi au feu on l’asticotait pour qu’il cherche une sortie et finisse par la trouver en s’ouvrant un passage avec ses griffes et ses dents.
Le supplice de la cloche: au milieu d’un jardin paradisiaque, agrémenté de paons, de faisans, de coqs de Malaisie, une cloche immense sous laquelle était attaché un homme jusqu’à ce que mort s’ensuive sous l’effet des vibrations.
Le bourreau-esthète concluait que le snobisme occidental, avec ses cuirassés, ses canons à tir rapide et ses explosifs, rendait «la mort collective, administrative et bureaucratique... Toutes les saletés de votre progrès, enfin... détruisent peu à peu, nos belles traditions du passé... » Tout en se promenant dans le jardin des supplices, Clara manifeste à son interlocuteur sa fascination pour l’Orient.
- Vois, mon amour, comme les Chinois sont de merveilleux artistes et comme ils savent rendre la nature complice de leurs raffinements de cruauté!... En notre affreuse Europe qui, depuis si longtemps, ignore ce que c'est que la beauté, on supplicie secrètement au fond des geôles, ou sur les places publiques, parmi d'ignobles foules avinées... Ici, c'est parmi les fleurs, parmi l'enchantement prodigieux et le prodigieux silence de toutes les fleurs, que se dressent les instruments de torture et de mort, les pals, les gibets et les croix... Tu vas les voir, tout à l'heure, si intimement mêlés aux splendeurs de cette orgie florale, aux harmonies de cette nature unique et magique, qu'ils semblent, en quelque sorte, faire corps avec elle, être les fleurs miraculeuses de ce sol et de cette lumière...
Il est curieux d’entendre cette déclaration, fût-ce dans la bouche d’un personnage, dans l’oeuvre d’un écrivain aussi vigoureusement anticlérical – voir L’Abbé Jules – que l’était Mirbeau. Car cette hypocrisie n’a pas toujours été de mise en Europe, où l’Église, pendant des siècles, n’a jamais caché qu’elle torturait. De ce point de vue, l’Inquisition a été d’une honnêteté à toute épreuve... Le jardin des supplices, Mirbeau n’avait pas besoin d’aller le chercher en Orient. Savoir faire souffrir, c’est aussi un art de chez nous!
En 1376, l’inquisiteur dominicain Nicolas Eymerich a élaboré le Directorium Inquisitorum [“manuel des Inquisiteurs”], véritable traité de réglementation de la torture, qui a été complété par la suite, en 1585, par un autre dominicain, le canoniste espagnol Francisco de la Peña. Ce travail conjoint a abouti à une oeuvre minutieuse, qui comporte 744 pages de textes et 240 pages d’appendices. L’oeuvre est insolite en ce sens qu’aucune nation au monde n’a osé assumer la torture comme pratique légale et parfaitement justifiable.
L’Inquisition, elle, a osé. Pendant plusieurs siècles, à partir du XIVe, la torture a été un instrument d’investigation tout à fait légitime. On recourait à la torture quand le crime, à défaut de preuves, était considéré comme probable, quoique non certain. Même les témoin pouvaient être torturés, en cas de contradictions. On torturait aussi bien des fillettes de treize ans que des femmes de quatre-vingts. Comme on ne pouvait infliger la torture qu’une seule fois, les inquisiteurs – qui appliquaient respectueusement la loi dans toute sa rigueur – avaient créé le subterfuge de l’ajournement de la session, pour pouvoir reprendre par la suite lês séances de tortures. La suppression de l’héritage du condamné était prolongée jusqu’à la troisième génération. Et si l’accusé échappait par la fuite à l’Inquisition, ou mourait avant d’être jugé, il était exécuté en effigie, c’est-à-dire qu’on brûlait son image. Même la mort n’épargnait pas le bûcher au malheureux!
Allons aux sources, c’est-à-dire au Directorium Inquisitorum:
On torture l’accusé afin de lui faire confesser ses propres crimes. Voici les règles que l’on doit suivre pour pouvoir recourir à la torture. On ordonne la torture pour:
1. Un accusé qui se contredit dans ses réponses, ou qui nie le fait principal.
2. Celui qui, parce qu’il a la réputation d’être hérétique, ou que la preuve de as diffamation a été déjà apportée, a contre lui un témoignage (fût-il unique) affirmant qu’on l’avait vu faire ou dire quelque chose de contraire à la foi; il s’ensuit qu’un témoignage ajouté à une mauvaise réputation antérieure de l’accusé constitue déjà une demi-preuve et est un indice suffisant pour qu’on ordonne la torture.
3. Au cas où ne se présenterait aucun témoin, mais où, à la diffamation, s’ajouteraient d’autres indices forts, fût-ce un seul, on devrait aussi recourir à la torture.
4. S’il n’y a pas d’accusation d’hérésie, mais s’il y a un témoin qui dise avoir vu ou entendu faire ou dire quelque chose de contraire à la Foi, ou s’il apparaît de forts indices, un ou plusieurs, c’est suffisant pour qu’on procède à la torture. Il s’ensuit la formule de la sentence de torture : «Nous, F..., Inquisiteur, etc., considérant avec attention le processus instruit contre toi, voyant que tu as varie dans tes réponses et qu’il y a contre toi des preuves suffisantes, afin de tirer de ta bouche toute la vérité, et pour que tu ne fatigues plus les oreilles de tes juges, nous jugeons, déclarons et décidons que tel jour, à telle heure, tu seras soumis à la torture.»
Longues sont les digressions d’Eymerich sur la torture. En voici quelques-unes.
Une fois lue la sentence de torture, et pendant que les tortionnaires se préparent à l’exécuter, il convient que l‘Inquisiteur et d’autres gens de bien fassent de nouvelles tentatives pour pousser l’accusé à confesser la vérité. Les bourreaux procèderont au déshabillage du criminel avec un certain trouble, avec précipitation et tristesse, afin de le terrifier de la sorte ; dès qu’il aura été dénudé, qu’on le prenne à part et qu’on l’exhorte de nouveau à avouer. Qu’on lui promette la vie sauve à cette condition – à moins qu’il ne soit relaps, auquel cas on ne peut la lui promettre. Si tout cela se révèle inutile, qu’on le conduise à la torture, au cours de laquelle il sera soumis à un interrogatoire, en commençant par les articles les moins graves dont il est suspect, afin qu’il confesse les fautes légères de préférence aux plus graves. Au cas où il s’obstinerait toujours à nier, qu’on lui mette sous les yeux les instruments d’autres supplices et qu’on lui dise que, à moins de confesser toute la vérité, il va les subir tous. Si pour finir l’accusé ne confesse rien, on peut continuer à le torturer un deuxième jour et un troisième jour, mais à la condition de suivre l’ordre des supplices, et de ne pas répéter ceux qui ont déjà été pratiqués, car on ne peut les répéter tant que n’apparaissent pas de nouvelles preuves (mais il n’est pas interdit, en ce cas, de poursuivre dans l’ordre).
Si l’accusé a supporté la torture sans rien confesser, l’Inquisiteur doit le remettre en liberté au moyen d’une sentence dans laquelle il constatera que, après un examen attentif de son procès, on n’a trouvé aucune preuve légitime contre lui, relativement au crime dont il a été accusé.
C’est-à-dire que, si le malheureux n’a pas avoué, ou n’a rien à avouer et n’a rien contre lui, il est relâché et tout s’arrête là. Selon l’inquisiteur Bernard Gui, «l’inquisiteur doit être diligent et plein de ferveur dans son zèle pour la vérité religieuse, pour le salut des âmes et pour l’extirpation des hérésies». En 1634, à Loudun, les inquisiteurs ont torturé avec diligence – et même avec amour ! – Urbain Grandier, avant de le livrer au bûcher. L’exorciste jésuite Jean-Joseph Surin a beaucoup souffert de n’avoir pu arracher à Urbain Grandier un Abjuro, ce qui aurait au moins sauvé son âme. Parce que le corps, lui, était de toute façon condamné aux flammes.
La diligence et la ferveur des Inquisiteurs ont été telles qu’ils ont même envoyé au bûcher une vierge de dix-neuf ans, en 1431, à Rouen. Elle s’appelait Jeanne d’Arc, et elle est aujourd’hui une sainte de cette même Église qui l’a brûlée...
Il n’est donc pas vrai que, comme le prétend Clara, on ait torturé en secret au fond des prisons. En vérité, Mirbeau n’avait pas besoin de transporter ses fersonnages en Orient pour faire l’éloge de la torture. Je m’en suis rendu compte dans les années 1980, quand j’ai visité à Tolède une exposition itinérante, intitulée «Instruments de torture, du Moyen Âge à l’époque industrielle». Leur accumulation, dans le musée,n’avait rien à envier au jardin de Mirbeau!
En parcourant les ruelles de l’antique capitale espagnole, j’ai demandé à un passant où se trouvait le musée des tortures. Une brave dame a d’abord hésité à me donner l’information. «Nous avons une cathédrale imposante, pourquoi n’allez-vous pas la visiter?» La cathédrale de Tolède est en effet imposante, et je l’avais visitée. Maintenant je voulais savoir comment elle avait été construite. Les informations qui suivent sont extraites du catalogue de l’exposition.
Dès l’entrée régnait, souveraine, la Demoiselle de Fer. Pour qui a déjà vu de vieux films d’horreur, rien de nouveau. La Demoiselle en question est une espèce de sarcophage à deux portes, dans l’intérieur desquelles sont fixés des clous qui s’enfoncent dans le corps de la victime quand on ferme l’appareil. Elle a été fort en usage à partir du seizième siècle et possède des raffinements: les clous sont fixés de manière à ne pas léser les organes vitaux, car il n’y aurait décidément aucun charme à ce que le sarcophage mal fermé tue la victime...
La chronique de l’époque dit, à propos d’un faux monnayeur soumis aux embrassements de la Demoiselle: «Les pointes les plus aiguës s’enfonçaient dans ses bras, dans ses jambes, à plusieurs endroits, et dans le ventre et la poitrine, et dans la vessie et à la racine du sexe, et dans les yeux, les épaules et les fesses, mais pas au point de le tuer; et il est resté ainsi à hurler et à se lamenter pendant deux jours, au terme desquels il est mort.» Dans les films d’horreur de notre adolescence, le héros trouvait toujours le moyen d’échapper aux bras de la Demoiselle. Mais il n’en allait pas de même au Moyen Âge...
Dans la même salle on rencontrait encore la hache et l’épée à décapiter, instruments qui avaient animé de grandes fêtes publiques en Europe centrale et dans les pays nordiques il y a quelque 150 ans. Aujourd’hui encore la télévision ou les journaux nous montrent que l’on pratique cet art antique dans les pays orientaux. Si le burreau était habile, la victime avait de la chance. Dans le cas contraire, c’est dans sa propre chair qu’elle devait souffrir des diverses tentatives de l’apprenti-bourreau...
Continuons! Toujours dans l’entrée du musée, solennelle et sinistre, se dresse la guillotine qui, pendant la Révolution Française, fut considérée comme un instrument d’humanisation de la peine de mort, au point de mériter le surnom d’amie du peuple. Louis XVI et Marie-Antonette, en 1793, avaient mérité son hommage, après quoi on se mit à appeler la machine la louisette. Son inventeur, le médecin français Joseph-Ignace Guillotin, aurait été par la suite soumis à sa propre invention, mais cela n’est pas historiquement fondé, puisqu’il est mort dans son lit en 1821. Ce qui est vrai, en revanche, c’est que la guillotine n’a été abolie en France que sous le règne de Mitterrand. Rien à voir, donc, avec le Moyen Âge, mais ce n’en est pas moins sinistre.
Villiers de L’Isle-Adam, un des précurseurs méconnus du modernisme en littérature, il y a plus d’un siècle, se souciait de nouveaux instruments de mise à mort. Dans un de ses Contes cruels, un médecin, pénétré de l’esprit de recherche des Lumières, essaie de convaincre un condamné à mort d’apporter une ultime contribution à la recherche neurologique au moment de son exécution; lui, le médecin, serait à côté de la guillotine, à côté du panier destiné à recueillir la tête du condamné. Ne pourrait-il pas – au nom de la science, bien sûr – répondre en clignant légèrement des yeux, après la chute de la lame, pour confirmer la continuité de la conscience après la séparation de la tête et du corps? Le condamné accepte la proposition, mais son geste est si vague qu’il ne permet pas au chercheur de conclure quoi que ce soit. Aujourd’hui l’on sait qu’une tête coupée, à la hache ou à la guillotine, continue d’être consciente pendant qu’elle roule et tombe dans le panier. Ce qui doit être une sensation pour le moins désagréable!
Juste après vient la roue. Tous nous avons déjà vu, dans des tableaux ou des gravures du Moyen Âge, voire dans des films qui font référence à cette époque, d’interminables séquences de corps agonisants, attachés sur une espèce de roue de charrette dressée sur un pieu. Très souvent, au cours de ma vie, j’ai vu des reproductions de telles scènes et je me suis toujours imaginé qu’on laissait là les cadavres des condamnés pour servir d’exemple et pour l’édification de la plèbe. En fait, il n’en est rien, et heureux serait le condamné s’il en était ainsi!
La roue pour déchirer – comme on l’appelait – a constitué l’instrument d’exécution le plus fréquent, après le gibet, dans l’Europe germanique, depuis le bas Moyen Âge jusqu’au XVIIIe siècle. Et son emploi est un peu plus sophistiqué que je ne l’imaginais.
La victime était allongée nue, la bouche vers le haut, par terre ou sur un échafaud, les membres écartés et attachés à des piquets ou des anneaux de fer. Sous les poignets, les coudes, les genoux et les quadriceps étaient placés des morceaux de bois. Le bourreau, en assénant de violents coups avec la roue s’employait à la briser, os après os, articulation après articulation, y compris les épaules et les quadriceps, mais en prenant toujours bien soin de ne pas asséner de coups mortels.
D’après une chronique anonyme du XVIIe siècle, la victime se transformait alors en «une espèce de grande marionnette qui gémissait et se tordait de douleur, telle une pieuvre géante à quatre tentacules, au milieu de ruisseaux de sang, de chair crue, visqueuse et amorphe, mélangée à des éclats d’os brisés».
Mais tout serait trop simple si la torture s’arrêtait là. Après avoir été brisée de la sorte la victime était détachée et allongée sur les rayons de la grande roue horizontale, au bout d’un poteau que l’on dressait alors. Ensuite les corbeaux entraient en action, arrachant de petits bouts de chair, piochant dans les yeux, jusqu’à ce que mort s’ensuive. Cela faisait du supplice de la roue l’agonie la plus longue et la plus atroce que le pouvoir était en mesure d’infliger.
À côté du bûcher se trouve l’écartèlement – dit le catalogue des horreurs que j’ai déniché dans le musée. C’était un des spectacles les plus courus, parmi tant d’autres de la même farine, qui avaient lieu quotidiennement sur les places d’Europe. Des foules de nobles et de plébéiens se délectaient avec un bon dépeçage, surtout quand c’étaient plusieurs femmes à la suite qui y devaient le subir...
Il y a aussi la cage, qui est beaucoup plus simple. On suspend la victime dans une cage de bois ou de fer, jusqu’à ce qu’il meure de froid, de faim, ou dévoré par les corbeaux. Une version encore plus simple et pratique de ce mode de mise à mort est de pendre le condamné par les pieds sur une barre horizontale, à laquelle sont également accrochés, de chaque côté, deux chiens affamés.
Puis vient la scie, fort usitée au XVIIIe siècle, et de création espagnole. À part les dents qui sont davantage espacées, elle ne diffère en rien d’une prosaïque scie à bois. À en juger par la gravure qui explique son utilisation, il m’a semblé que le bourreau de ce siècle manquait d’imagination: on suspendait en effet la victime par les pieds à une barre, et deux hommes s’employaient à la scier à partir du coccyx.
Torture idiote, pensais-je, car l’homme devait mourir dès le début du supplice. Mais quelle ingénuité était la mienne! À cause de l’inversion de la position du corps, qui garantit une oxygénation suffisante du cerveau, et empêche une perte de sang trop importante, la victime ne perdait conscience que quand la scie atteignait le nombril, et parfois même la poitrine.
Bien qu’on associe ce supplice à l’Espagne, son origine remonte à une époque à laquelle personne ne pensait en Espagne. Les lecteurs attentifs des versions anciennes de la Bible doivent se souvenir que le sage roi David (II Samuel 12:31) extermina les habitants de Rabbah et de toutes les autres villes ammonites en infligeant le supplice de la scie, ainsi que d’autres supplices sophistiqués de l’époque, à tous les habitants, hommes femmes et enfants. On l’appliquait avec prédilection aux homosexuels des deux sexes. (Dans les versions modernes de la Bible on a fort atténué cette référence à la scie, qui n’est mentionnée que comme instrument de travail...).
En Espagne, elle a été utilisée comme méthode d’exécution militaire; dans l’Allemagne de Luther, elle était destinée aux chefs des paysans révoltés; et, en France, la “justice” y condamnait les femmes possédées par Satan.
Plus loin, nous trouvons le “coin de Judas”, une pyramide de bois à la pointe aiguë supportée par un trépied. Pas besoin de beaucoup d’efforts d’imagination pour comprendre sa finalité. La victime, nue, est hissée par des cordes, de telle façon que tout son poids repose sur un point situé dans l’anus ou dans le vagin. Le bourreau, selon ce qu’ont déterminé les interrogatoires, peut modifier la pression du poids du corps et aussi le secouer à plusieurs reprises sur le coin.
Au milieu de ces instruments de mort les plus brutaux, le musée en exhibait d’autres, à l’apparence anodine, mais qui n’en avaient pas moins d’efficacité. Par exemple, les cravaches avec une boule de fer aux pointes aiguës. Son utilisation ne requiert pas de pratique ou d’habileté particulières. Mais il y a une autre cravache à l’apparence plus innocente, et qui est pourtant d’une atroce efficacité: c’est la cravache pour écorcher. C’est un fouet de cuir, avec des dizaines de cordes apparemment inoffensives. À l’extrémité de chacune de ces cordelettes il y a une pointe de fer fort aiguisée. Les cordes étaient trempées dans une solution de sel et de soufre dissous dans l’eau, de telle façon que la victime, au fur et à mesure qu’elle était fustigée, voyait sa peau se réduire à l’état de pulpe et que, à la fin du supplice, ses poumons, ses reins, son foie et ses intestins étaient exposés à la vue du public. Pendant tout ce processus, la zone affectée était humidifiée avec la solution presque bouillante...
Voici quelque chose d’encore plus prosaïque, prouvant que l’imagination pour faire souffrir son prochain est ce qui fait le moins défaut à l’être humain: un simple entonnoir et quelques seaux d’eau. La victime est inclinée, les pieds vers le bas, et on l’oblige à avaler d’énormes quantités d’eau à travers l’entonnoir, jusqu’à ce que le nez soit bouché, ce qui l’oblige à ingurgiter tout le contenu de l’entonnoir avant de pouvoir respirer une gorgée d’air. Sans même parler de la terreur de l’asphyxie, constamment renouvelée, quand l’estomac se relâche et enfle d’une manière grotesque, le supplicié penche la tête vers le bas. La pression contre le diaphragme et le coeur occasionne des souffrances inimaginables, que le tortionnaire intensifie encore en frappant l’abdomen. Cette pratique est encore en usage de nos jours, parce qu’elle est facile à administrer et qu’elle ne laisse pas de traces visibles qui la dénoncent.
Quoi d’autre encore? Car nous ne faisons qu’entrer dans le musée... En continuant, il y a les araignées espagnoles, que l’on appelle aussi les araignées de sorcières. C’est un instrument à la structure rudimentaire : des griffes métalliques à quatre pointes en forme de tenailles, que l’on utilise aussi bien froides que rougies au feu, pour hisser la victime en l’attrapant par les fesses, par les seins ou par le ventre, ou encore par la tête, en général avec deux pointes dans les yeux et les deux autres dans les oreilles...
Cette promenade est encore loin de son terme, et je ne fais que la résumer. Il y a par exemple une cigogne, également appelée “la fille de l’éboueur”. Elle est constituée de quatre tiges métalliques qui attrapent en même temps le cou, les mains et les jambes du supplicié. À première vue, ce n’est qu’une méthode de plus pour immobiliser, mais en quelques minutes la victime est assaillie de fortes crampes, qui affectent d’abord les muscles de l’abdomen et du rectum et, ensuite, les pectoraux, les cervicales et les extrémités. Au fil des heures, la cigogne produit une agonie continue et atroce, qui peut être intensifiée, selon le bon plaisir du bourreau, au moyen de coups de pied ou de poing ou de mutilations diverses.
Les menottes de fer, pour les poignets et les chevilles, je les laisse de côté. Arrêtons-nous quelques secondes devant un petit instrument d’une conception rudimentaire, mais dont les effets sont abominables. C’est un écrase-tête, certifié italien, contribution vénitienne aux arts du Moyen Âge, beaucoup utilisé de nos jours. C’est une espèce d’étau muni d’un casque, qui comprime la tête du condamné contre une barre métallique. Les commentaires sont superflus: ce sont d’abord lês alvéoles dentaires qui sont démolies, ensuite les mandibules, jusqu’à ce que le cerveau se mette à couler par les cavités des yeux et à travers les interstices des fragments du crâne...
Il existe d’autres versions plus simples du même instrument, avec la même finalité, par exemple un arc métallique qui se ferme autour de la tête, avec des clous à l’intérieur, histoire de perforer la boîte crânienne.
Il y a des techniques si élémentaires qu’elles semblent avoir été conçues par un débile mental. La tortue, par exemple: on étend la victime par terre et on pose sur elle une surface carrée de bois, sur laquelle on va empiler un poids de plusieurs quintaux. Pour accroître la souffrance, on peut ajouter, sous le dos du supplicié, une cale transversale de forme triangulaire qu’on appelle “bascule”.
Ou encore le crochet à hérétiques: une vraie trouvaille, pratique, bon marché, et extrêmement efficace! Que le lecteur imagine une espèce de fourche, avec deux pointes à chaque extrémité. Deux de ces pointes sont enfoncées profondément sous lê menton, tandis que celles de l’autre extrémité sont appuyées sur l‘extérieur. Une poignée de cuir fixe le crochet contre le cou. Le crochet, au fur et à mesure qu’il pénétrait dans les chairs, empêchait tout mouvement de la tête, mais permettait à l’accusé d’hérésie de dire, d’une voix toute faible, abjuro, mot qui était gravé sur un des côtés de l’instrument.
Ou encore le bâillon, appelé également “bavoir de fer”: c’est une sorte de collier en fer, avec une espèce d’entonnoir aplati sur la partie interne du cercle, que l’on enfonçait dans la bouche du torturé, jusqu’à ce que le collier soit fixé dans la nuque. Un petit trou permettait à l’air de passer, ce qui permettait aussi au bourreau d’asphyxier son prisonnier en obstruant le trou d’un simple geste du doigt. Giordano Bruno, une des intelligences les plus brillantes de son époque – et c’est précisément en cela que consistait son crime – fut brûlé par l’Inquisition en 1900 et auparavant soumis à l’un de ces bâillons dotés de deux longues pointes, l’une qui perforait la langue et qui ressortait par la partie inférieure du menton, tandis que l’autre perforait le palais.
Dans une autre salle du musée, aussi solennelle que la Demoiselle de Fer, se trouve une chaise pour interrogatoires, une espèce de fauteuil métallique, entièrement tapissé de clous très aigus, du dossier jusqu’au siège, y compris dans sa partie inférieure, qui continue près de la jambe et sous les pieds. On pouvait augmenter le supplice en assénant des coups secs sur les membres ou en plaçant un brasier sous le siège. Des versions modernes de cet instrument sont fort appréciées par les polices de tous les pays, et au Brésil – nous devons tous nous en souvenir – nous avons eu la chaise du dragon.
Le bûcher, nous le connaissons tous, car sans lui il n’y a pas de Fêtes de la Saint-Jean. À cette différence près que, dans ce bienheureux Moyen Âge, on ne l’utilisait pas exactement pour griller des pignons, et que l’Église s’est même payé le luxe de griller une sainte. Si vous voulez davantage de détails sur ce qui s’est passé, vous pouvez lire Gilles et Jeanne, de Michel Tournier, roman que j’ai eu l’honneur de traduire au Brésil.
Mais le bûcher, qui ne requiert que peu ou pas du tout d’art, en exigeait beaucoup à cette époque où les arts, comme on le sait, ont connu un développement extraordinaire. Les bourreaux les plus créatifs ont mis au point une version plutôt ingénieuse: la victime était attachée à une échelle, que l’on penchait au-dessus des flammes, dans le plus pur style des barbecues gauchos... Dans quelques exécutions, on attachait à la poitrine des suppliciés un sac plein de poudre.
Il y avait aussi le taureau, moyen encore plus sophistiqué. Il s’agissait simplement d’un taureau de métal, dans lequel on plaçait le condamné. Après quoi on allumait dessous un bûcher, et le taureau se mettait à mugir, histoire d’amuser le public. Il paraît que, dans des versions orientales de cet instrument, un système complexe de
tubes transformait en une espèce de musique les hurlements du malheureux...
Voici maintenant le poulain, d’origine italienne. Nous en aurons tous vu, ne serait-ce que dans des revues ou de petits tableaux, car il est devenu un des instruments les plus symboliques des souterrains de l’Inquisition. C’est une table où le condamné est attaché par les pieds et les mains et où l’on passe un cabestan pour étirer ses membres. Des témoins anciens citent des cas où on a pu allonger ainsi un être humain de plus de trente centimètres, grâce à la désarticulation des bras et des jambes, au démembrement de la colonne vertébrale et au déchirement des muscles des extrémités, du thorax et de l’abdomen, et tout cela, bien sûr, avant la mort du patient...
Pour leur part, les femmes méritaient bien des attentions et des instruments spécifiques, qui tous mutilaient leurs organes sexuels. Des tenailles incandescentes pour leur écraser les mamelons, des griffes pour leur déchirer les seins ou les fesses, etc. Une trouvaille digne d’être mentionnée: la poire, objet en bois en forme de poire, que l’on introduisait dans le vagin des pécheresses ou dans l’anus des homosexuels; après quoi, au moyen d’une vis, on ouvrait la poire en quatre pour lui donner le maximum d’extension.
Le défilé d’horreurs de notre jardin se poursuit, je ne les ai pas tous compilées, et je crois que même ceux qui ont organisé l’exposition du musée de Tolède ne parviendront pas à cataloguer tous les moyens que l’homme a créés pour faire souffrir son prochain. Mais, avant de conclure, je prends la liberté de citer encore cette merveille qui permet de vérifier à coup sûr si une femme est une sorcière ou non. On attachait l’accusée par les mains et les pieds et on la jetait dans une rivière. La vérification était immédiate et d’une clarté limpide: comme l’eau est un élément pur et innocent, si la femme est une sorcière, la rivière la rejettera et la fera flotter, et il n’y aura plus qu’à conduire la femme au bûcher et à la brûler ; si au contraire l’eau acceptait la femme, celle-ci se noyait, mais du moins son innocence était-elle prouvée...
Mirbeau a préféré situer son jardin en Chine. Néanmoins, nous, les occidentaux, nous ne devons rien à la Chine en matière d’art de la torture et de la mise à mort. Faisans et paons mis à part, son jardin chinois, c’est aussi le nôtre!
![]()
